Cet article a été écrit à la suite des manifestations contre Exhibit B et de leur traitement médiatique. Il va sans dire que les derniers évènements et le climat actuel en France sont également soumis à cette mythologie antiraciste qui sera développé ci-dessous. Les “incidents”,”dérapages”islamophobes à répétition, le climat anxiogène qui bouche et repousse davantage une vraie discussion, en faveur d’une ode à l’unité, contribue à nous enliser dans des non-dits. ! J’ai beaucoup réfléchi, lu, et tenté d’appréhender ce grand tableau, et il est évident que quelques posts de blogs ne suffisent pas à recouvrir le sujet, et que d’autres minorités ethniques rencontrent le même processus, avec leurs similitudes et leurs différences. Malgré tout, il me semble important que les choses ici soient relevées, afin de désamorcer la xénophobie décomplexée et grandissante.
______________________________________________________________
Depuis le 27 novembre, les manifestations contre Exhibit B se sont organisées successivement devant le Théâtre Gérard Philippe, puis devant le 104, dans le 19e. J’ai eu l’occasion d’être aux milieux de ces personnes noires que l’on regardait, tantôt du haut des fenêtres du théâtre, tantôt d’une page d’un journal sous le mot de « censeurs », « groupes extrémistes ». ( et autres surnoms qui ont été donné à moi, et également à celleux qui ont manifesté, comme cette femme que cinq policiers ont traîné par ses tresses sur plusieurs mètres pour la saisir). En somme, je pensais que la violence policière, les manifestations regroupant plusieurs communautés noires, et le racisme seraient des similitudes suffisantes pour être traités pour ce qu’elles sont : les symptômes d’un racisme systémique, les mêmes qui ont été pointés pour Ferguson. Quelle fut donc ma surprise de voir ce grand écart de l’antiracisme français, capable de voir aisément les policiers américains blancs face à une majorité de manifestants noirs comme les enjeux d’une violence raciste, sans voir qu’à quelques rues, se jouait exactement la même scène à Paris.
Cette distanciation avait déjà été évoquée parallèlement à la médiatisation des manifestations de Ferguson : par leur article, Rokhaya Diallo et Sihame Assbague avaient souligné cette tendance où l’on pointe la violence policière aux Etats-Unis, sans aborder celle en France ; une manière de ramener la focale des médias sur le cas français, trop peu étudié. Toutefois, le traitement des manifestations contre l’exposition de Brett Bailey est davantage révélateur de cette demi-mesure : à travers les différents médias français de renom, l’antiracisme médiatisé – que j’appellerais l’antiracisme de la tribune – s’est considérablement fait remarqué : une justification bancale de leur antiracisme en utilisant… le racisme.
Mais de quoi parle-t-on exactement ? En effet, comment peut-on expliquer cette distanciation du racisme quand des situations similaires ont lieu en France ? Comment le même « motif » – des manifestations de personnes noires dénonçant les agressions racistes qu’elles subissent devant un corps policier majoritairement blanc – peut-il être traité d’une manière si radicalement opposée ?
Dans le premier cas, les médias français s’accorderont volontiers sur la dimension structurel et étatique du racisme aux Etats-Unis ; ils signaleront la violence physique et morale subies par les Afro-américains et leur passé historique. Mais, dans le second cas, les manifestants noirs Français seront résumés à des « casseurs », des « groupes extrémistes » « qui ne comprennent pas » pour la simple raison qu’ils s’expriment sur l’oppression qu’ils subissent. Dans cette répartition du droit à la parole, comment les auteurs de ces traitements différents peuvent-ils se prétendre antiracistes ?
Le racisme, un récit en noir et blanc
« Black », « rebeu », « renoi », autant de synonymes que le mot « blanc » ne possède pas lui-même : le racisme, c’est d’abord une affaire de mots qui constituent un récit. Si l’Assemblée nationale a adopté le 16 mai 2013 la suppression du mot “race”, c’est bien dans une tentative d’affecter un discours sur le racisme (et non un discours raciste, comme suppose cette loi, mais ceci est un autre débat). Cette même décision législative est aussi le symptôme d’un antiracisme qui ne se connaît pas vraiment : désormais, on pense aujourd’hui qu’il est raciste et gênant, de dire les mots « noir » et « arabe », comme le montre la Une de Libération qui titre « un jeune black à Ferguson », alors que la stigmatisation est précisément dans ce qui est attribué à ces couleurs de peau, et non au fait de les nommer pour ce qu’elles sont. Dire que je suis noire n’est pas raciste, mais c’est ce que cela signifie et implique aux yeux des autres, de leur mentalité, de l’Etat, en somme, de l’extérieur, qui est raciste. La question n’est donc pas de nommer ma couleur ou non, mais plutôt pourquoi vous vous ressentez le besoin de me réduire à celle-ci…
Par conséquent, la substitution d’un mot, la suppression du mot « race » est la preuve qu’en France, on pense pouvoir traiter le racisme par sa surface, ignorant son impact structurel.
La race est une construction sociale qui a été utilisée pour justifier l’esclavage, la colonisation, le massacre des Amérindiens, entre autres discriminations historiques de “minorités ethniques”. Il en résulte aujourd’hui une narration occidentale tronquée. Ainsi, on marquera la découverte de l’Amérique du Nord à celle de Christophe Colomb comme si la population qui y habitait ne comptait pas. Et beaucoup d’autres découvertes ont un point de vue occidento-centré, ignorant d’autres récits, d’autres acteurs.
Ces omissions évidentes ont leurs répercussions sur les générations afrodescendantes d’aujourd’hui, notamment à travers un discours xénophobe du « moins Français », alors même que l’on « oublie » de citer dans l’histoire de France que Brazzaville, capitale du Congo, a été la capitale temporaire de la France libre en 1944. Il faut croire que le sol brazzavillois devait sembler assez français à cette époque. C’est un exemple parmi tant d’autres, comme la contribution de soldats étrangers durant les guerres (non, un reportage sur Arte une fois tous les cinq ans sur les tirailleurs sénégalais ne suffit pas à contrebalancer l’enseignement qui est fait à l’école).
(Beaucoup ont tendance à résumer cela à “l’Histoire est écrite par les vainqueurs”, mais je trouve cela réducteur quand cette narration s’appuie sur le pillage d’autres cultures, et l’asservissement de celles-ci.)
Le racisme a donc son propre récit dont les auteurs ne sont pas les premiers concernés.
Contraintes de construire leur identité dans un système raciste, les victimes de discriminations raciales se réapproprient peu à peu cette narration: Aisha Harris écrivait par exemple, « Je suis noire-américaine, pas afro-américaine », questionnant ainsi la place de son afro-descendance dans son identité, face au regard des autres et pour elle-même. Se réapproprier d’une Histoire déjà écrite, c’est d’abord se raconter, se situer. A l’échelle individuelle, cela s’exprime davantage comme un besoin de se nommer et de se connaître, et de rompre avec le statut du “Bon/Bonne noir/e” que la société tend à nous apposer. Mais cette réappropriation n’est pas nouvelle !
“Il vole, il agresse, il fraude”
Cette réappropriation a donné lieu à des travaux universitaires marquants, notamment dans l’afroféminisme. On peut citer par exemple l’essai Women, sex and race, où Angela Davis retraçait les différents échecs des universitaires blancs à restituer le quotidien des femmes esclaves au cours de l’histoire : quand bien même ils se posaient tous comme étant favorables à l’abolition de l’esclavage, et en antiracistes, leurs théories étaient incapables d’éviter des stéréotypes racistes. Il en est de même pour des féministes américaines blanches qui, à la même époque, soucieuses de sauver leurs sœurs noires des hommes noirs et de l’esclavage, s’inscrivaient dans ce schéma du « sauveur blanc » et alimentaient ce que Davis nomme le Mythe du violeur noir ; soit un mythe ancré dans un imaginaire raciste et instrumentalisé par la société américaine blanche. Ce mythe fut si néfaste qu’il permit le lynchage d’hommes noirs dans plusieurs villes des Etats-Unis, jusque dans les années 30.
Il y a donc une critique d’une narration qui, quand bien même elle repose sur de bonnes intentions, ne remplace pas la parole et les expériences des concerné-e-s.
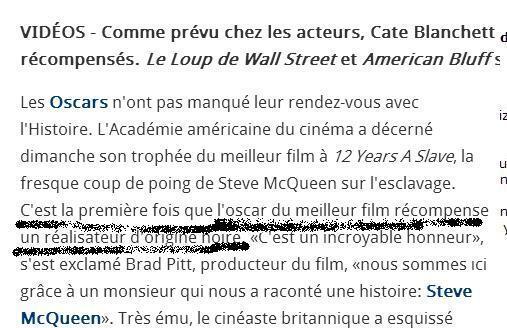
Autre étude, cette fois en littérature, c’est l’essai Playing in the Dark où la talentueuse, remarquable, inspirante et excellente la lauréate du Prix Nobel Toni Morrison décortique les plus grands classiques de la littérature américaine pour montrer l’ampleur du white gaze (regard blanc) et la manière dont il altère la narration et a des incidences sur la description des racisé-e-s, de leurs aspirations. Par exemple, elle démontre que le mythe du Nouveau Monde ou Monde libre qui consisterait à libérer un personnage racisé est souvent teinté d’un paternalisme blanc et d’une simplification du personnage.
Concrètement, là où certaines personnes privilégiées par le fait d’être blanches ont lu, sciemment ou non, les premiers paragraphes de cet article comme un parallèle entre la situation à Ferguson et celle en France ; des personnes victimes de racisme auront déjà saisi le rôle de la narration dans le maintien des inégalités raciales, puisqu’elles-mêmes sont victimes au quotidien de ces narrations racistes. Le délit de faciès repose entièrement sur ce principe de narration :
- Parce que X est un homme noir, il est susceptible de voler ou d’avoir volé, de frauder ou d’avoir fraudé, etc.
- Parce qu’elle est une femme noire, elle est susceptible d’avoir une sexualité débridée et sauvage, d’avoir quelque chose d’exotique qu’une autre femme n’aurait pas, d’être agressiveetc.
Le passé, le présent et le futur des racisés sont donc neutralisés d’avance par un imaginaire raciste : « ces noirs ont toujours été… », « ils vont faire ça…», « un jour ils risquent de faire…», comme le symbolise la “théorie” du “Grand remplacement”.
Ainsi, de la même manière qu’un discours raciste s’est forgé au fil des années aux dépends des racisé-e-s, un discours antiraciste a également évolué sans eux, reposant davantage sur des mythes que sur eux-mêmes…
Mais ça, ce sera pour le prochain post !

